Auteur : Legs Africa
Site de publication : Legs Africa
Type de publication : Rapport
Date de publication : Mars 2022
Lien vers le document original
Le contexte général
Les fortes inégalités sociales instaurées par les systèmes économiques tournés essentiellement vers le profit montrent l’urgence de trouver des modèles alternatifs innovants. En effet, selon un rapport d’Oxfam, près de la moitié des richesses mondiales sont détenues par seulement 1% de la population. Aussi, la richesse des 1% les plus riches s’élève à 110 000 milliards de dollars soit 65 fois la richesse totale de la moitié la moins riche de la population mondiale.
Face à cette situation, plusieurs pays se sont tournés depuis plusieurs années vers des modèles alternatifs tels que l’Économie Sociale et Solidaire en vue de réduire les inégalités selon les principes de coopération, de participation.
En Afrique l’histoire de l’ESS surtout selon ses principes d’humanisme, de liberté, de démocratie, de participation et de justice remonterait à la fameuse charte du Mandé de 1222 soit 7 siècles avant la proclamation de la déclaration universelle des droits de l’homme.
L’ESS de son acception moderne peut être définie selon trois entités que sont les acteurs qui en constituent le support (entrepreneurs, particuliers, salariés, etc.), les formes organisationnelles qu’elle revêt (société anonyme, association, fondation, entreprise mutualiste, etc.) ou bien encore en fonction des activités (insertion professionnelle, commerce équitable, aide aux personnes âgées, manifestations culturelles et/ou sportives, etc.
L’objectif général de l’étude est de procéder à une analyse de l’entrepreneuriat social au Sénégal au plan économique, mais aussi juridique, dans le but de proposer une réforme du cadre en le rendant plus favorable au secteur.
Analyse économique
Au Sénégal, après deux décennies d’ajustements structurels, le pays s’est engagé depuis le début des années 2000 sur le chemin de l’émergence, matérialisé par différents programmes de développement (notamment les DRSP 1 et 2 et l’actuel PSE) qui prônent, à côté d’un volet purement économique, une volonté manifeste de lutte contre la pauvreté, mais aussi de renforcement de la solidarité, de protection sociale et de la lutte contre l’exclusion.
Face à cette situation, plusieurs pays se sont tournés depuis plusieurs années vers des modèles alternatifs tels que l’Économie Sociale et Solidaire en vue de réduire les inégalités selon les principes de coopération, de participation
Cependant, force est de constater les limites. L’incidence de la pauvreté reste à des niveaux très élevés, même si des efforts ont été réalisés depuis l’année 2000. La situation de l’emploi est aussi assez préoccupante. C’est d’ailleurs ce qui explique que depuis 2015, l’ANSD (Agence Nationale de la Statistique et de la Démographie) réalise une Enquête Nationale sur l’Emploi au Sénégal (ENES) chaque année selon un calendrier trimestriel. Selon l’ENES de 2017, le taux de chômage est évalué à 15,7 %. Il est plus élevé en milieu urbain où 18,6 % de la population active est au chômage contre 13,1 % en zone rurale.
Dans ce contexte de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’économie sociale et solidaire pourrait être appelée à devenir une composante importante d’un nouveau modèle de développement. En réalité, face à la montée de la pauvreté et surtout des inégalités, les gouvernants prennent de plus en plus conscience que le modèle de développement économique et social qui a prévalu depuis les indépendances a montré ses limites.
Il faut dire que la mortalité des entreprises est assez élevée au Sénégal. En 2012, l’Enquête Nationale sur les PME (ENPME) a montré que 855 entreprises de la population cible ont cessé leurs activités, entraînant des pertes d’emplois et une baisse de la richesse créée. En effet, on estime que 60% des entreprises ne survivent pas à leur premier anniversaire. Les entreprises font face à des difficultés qui entraînent parfois des cessations d’activité. Cette vulnérabilité est souvent imputée à la structure des PME, mais aussi à l’environnement juridique et fiscal encore trop contraignant. À cela s’ajoutent les difficultés d’accès au financement.
En résumé, ces exemples montrent que l’entreprise sociale est véritablement une alternative à l’économie néolibérale. Son développement fulgurant dans les pays développés ces deux dernières décennies suggère qu’elle constitue sans conteste une solution dans la lutte contre les disparités et les facteurs d’exclusion engendrés par le capitalisme (chômage, marginalisation, pauvreté, inégalités, etc.). Pour les pays périphériques pauvres et laissés pour compte, l’entrepreneuriat social apparaît donc une opportunité de développer une économie à la fois plus humaine et plus durable et de créer des conditions d’un développement solidaire et inclusif.
L’entrepreneuriat social au Sénégal : évolution du cadre politique et institutionnel
Au Sénégal, des structures comme les GIE, des mouvements de promotion de l’entrepreneuriat féminin, des Associations de jeunes ont émergé depuis plusieurs décennies. Même si historiquement la présence des sociétés coopératives, des mutuelles et associations est assez connue dans le paysage des organisations, on découvre chaque jour davantage la diversité et l’importance des initiatives mises en avant dans des domaines variés : micro crédit, finance solidaire, commerce équitable, santé, production, assurances, éducation. Par contre, ce qui est totalement nouveau, c’est d’une part l’émergence d’entrepreneurs de plus en plus liés à l’économie sociale, mais aussi la formation d’un dispositif d’appui le développement de l’écosystème d’appui à l’entrepreneuriat social.
Au sortir des programmes d’ajustement structurel et post-ajustement, avec leur lot d’échecs et de coût social élevé, le gouvernement du Sénégal, conscient de l’importance de l’économie sociale et solidaire, a affiché une volonté de prendre en charge la dimension sociale dans sa politique économique.
Dans ce contexte de lutte contre la pauvreté et l’exclusion, l’économie sociale et solidaire pourrait être appelée à devenir une composante importante d’un nouveau modèle de développement. En réalité, face à la montée de la pauvreté et surtout des inégalités, les gouvernants prennent de plus en plus conscience que le modèle de développement économique et social qui a prévalu depuis les indépendances a montré ses limites
Adopté en 2014, le Plan Sénégal Emergent (PSE) est le cadre unique de référence du Sénégal en matière de Développement Économique et Social à l’horizon 2035. Le secteur de l’économie solidaire y est considéré comme un des piliers économiques devant contribuer à «la transformation de la structure de l’économie dans le sens de soutenir une dynamique de croissance forte et durable».
L’économie sociale est considérée comme un facteur d’inclusion et d’emplois, en ce qu’elle permet d’opérer une transition souple vers une économie formelle. Cette mutation s’opère par les actions fortes en faveur des secteurs de l’artisanat, du commerce, du microtourisme et du transport.
Comme soulevé au niveau de l’introduction, l’entrepreneuriat et plus particulièrement la petite entreprise, est soumise à de nombreuses contraintes. Ces contraintes ont amené le Gouvernement du Sénégal à prendre certaines mesures de politiques notamment des mesures réglementaires et législatives pour appuyer le développement de l’entrepreneuriat
Il faudra noter la création, en septembre 2017, d’un ministère dédié à l’économie solidaire dans le gouvernement sénégalais, ce qui constitue alors un grand pas vers une opérationnalisation plus concrète des mesures de politique économique en faveur de l’entrepreneuriat social. Toutefois, à ce jour, il est difficile d’évaluer la reconnaissance et la teneur des initiatives en faveur de ce secteur, vu le caractère récent du ministère et aussi de l’absence de données factuelles à tous les niveaux.
Profil socio-économique des entreprises sociales : analyse à partir des données des entretiens
Il n’existe pas de répertoire formel des entreprises sociales au Sénégal, et de ce fait elles sont très difficiles à identifier. De même, le dernier recensement des entreprises, s’il identifie clairement les formes traditionnelles telles que les coopératives, mutuelles et fondations, ne prend pas en compte les entreprises ces entreprises au statut classique, mais œuvrant en réalité dans l’économie sociale.
D’après le profil du secteur des entreprises d’ESS en Afrique de l’Ouest dressé par Fall (2013), on compterait près de 2 millions d’entreprises d’ESS dans les principaux centres urbains d’Afrique de l’Ouest. Leur poids dans l’économie nationale est en moyenne de 40% PIB et elles seraient aussi à l’origine de 90% de la création de nouveaux emplois.
Les unités interrogées se situent dans les régions de Dakar, Thiès et Fatick. Ce choix est évidemment guidé par la répartition des entreprises du LAMER. Toutefois, le Recensement Général des Entreprises (RGE) de 2016, qui a dénombré 407 882 unités économiques réparties sur l’ensemble du pays, a montré que la plupart des entreprises au Sénégal se situent dans la région de Dakar (39,5%), suivie de celles de Thiès (11,5%), ce qui montre que des entretiens portant principalement sur ces deux régions peuvent être assez représentatifs.
L’économie sociale est considérée comme un facteur d’inclusion et d’emplois, en ce qu’elle permet d’opérer une transition souple vers une économie formelle. Cette mutation s’opère par les actions fortes en faveur des secteurs de l’artisanat, du commerce, du microtourisme et du transport
L’analyse des données d’entretien permet de constater que l’entrepreneuriat social est loin d’être confiné dans une activité donnée. En effet, les entreprises rencontrées évoluent dans des secteurs d’activité très diversifiés. Il s’agit principalement de l’agroalimentaire (qui concentre le plus d’unités), de l’agroforesterie, la gestion des déchets, l’écotourisme, le Design et la confection, ou encore les services innovants.
La plupart des entreprises rencontrées sont établies en milieu urbain. Seuls un peu plus de 15% évoluent dans le milieu rural. Cela montre le potentiel et l’intérêt de développer de telles activités dans des zones fortement agglomérées et donc par définition confrontées à des défis sociaux multiformes.
La « jeunesse » des entreprises sociales peut aussi s’expliquer par le fait que ces structures se positionnent le plus souvent dans des domaines innovants, et donc par définition récents. Cela les rend aussi plus fragiles, si l’on considère que la plupart de ces projets exigent du temps avant que les produits ou les services proposés soient connus et acceptés par les populations et les partenaires (banques, bailleurs, etc.).
Conformément à leur objectif premier qui est social, il est apparu que les entreprises rencontrées ont une rentabilité économique plutôt modeste. Pour ce qui concerne le chiffre d’affaires, les données des entretiens révèlent que ces entreprises réalisent en moyenne un chiffre d’affaires compris entre 2 millions et 100 millions de francs CFA. Visiblement, ces entreprises sociales ont une rentabilité économique modeste.
D’après le profil du secteur des entreprises d’ESS en Afrique de l’Ouest dressé par Fall (2013), on compterait près de 2 millions d’entreprises d’ESS dans les principaux centres urbains d’Afrique de l’Ouest. Leur poids dans l’économie nationale est en moyenne de 40% PIB et elles seraient aussi à l’origine de 90% de la création de nouveaux emplois
Les emplois sont constitués de personnel permanent et d’une forte proportion de personnel non permanent. Le nombre d’employés est en moyenne de 8,11 personnes dans les entreprises sociales, soit un peu plus que le nombre relevé pour les PME de manière générale. La taille du personnel varie en général entre 2 et 25, avec une forte présence de personnel non permanent.
Pour ce qui concerne le niveau d’instruction, il apparait que la plupart des chefs d’entreprises ont un niveau universitaire. Ils sont 83% à avoir fait des études supérieures, contre 17% qui ont quand même fait des études secondaires. Cela est assez remarquable, si l’on sait que pour les PME en général, la proportion de chefs d’entreprises avec un niveau universitaire se situe à 38,7%.
Impact de l’entrepreneuriat social au développement humain durable et à l’insertion socioéconomique
Il s’agit ici d’effectuer des simulations et extrapolations afin de voir l’importance de l’entrepreneuriat social dans l’économie sénégalaise. Même si, il est vrai, que ces résultats ne sont pas extrapolables, il est possible de se fonder sur un certain nombre d’hypothèses pour procéder à une simulation de l’impact des entreprises sociales sur le plan économique et social.
Dans un monde de plus en plus capitaliste, le modèle entrepreneurial marchand a montré ses limites. Au niveau mondial, face à la montée des inégalités et la dégradation de l’environnement, la notion du développement durable est plus qu’incontournable dans la manière de mettre en œuvre les politiques économiques et sociales.
En partant sur le fait que le nombre d’entreprises sociales peut s’élever jusqu’à 45 000 unités, il parait évident que ces dernières constituent un grenier pour l’emploi et l’insertion sociale. On l’a vu dans la section précédente, les entreprises sociales emploient en moyenne 8,11 personnes. Le calcul est simple, cela représente des centaines de milliers d’emplois (plus de 350 000 emplois).
Comme le révèlent Megder et Badir (2016), les structures de l’ESS constituent une première source de revenus pour plusieurs femmes qui n’ont jamais travaillé à l’extérieur de leur foyer, et qui ont très peu de chances de s’insérer dans le monde de l’entreprise qui pour vocation exclusive la recherche de profit. Par exemple, les femmes voient dans la coopérative un lieu où elles se sentiront moins vulnérables. Il s’agit donc d’un changement énorme dans leur vie et sur lequel elles mettent beaucoup d’espoir. Beaucoup de structures rencontrées au Sénégal, et surtout celle dirigées par des femmes, admettent que l’autonomisation des femmes constitue en réalité l’objectif premier de leurs entreprises.
Conformément à leur objectif premier qui est social, il est apparu que les entreprises rencontrées ont une rentabilité économique plutôt modeste. Pour ce qui concerne le chiffre d’affaires, les données des entretiens révèlent que ces entreprises réalisent en moyenne un chiffre d’affaires compris entre 2 millions et 100 millions de francs CFA. Visiblement, ces entreprises sociales ont une rentabilité économique modeste
La forte implication des jeunes dans l’entrepreneuriat social permet l’insertion des jeunes avec des niveaux d’éducation le plus souvent élevés qui trouvent des projets innovants. Il permet aussi à des citoyens avec des niveaux d’éducation modestes et parfois loin de l’employabilité de trouver des emplois plus ou moins décents. Si l’on considère que les entreprises rencontrées déclarent que les jeunes de moins de 30 ans occupent 40 à 50% des emplois, on est dans un chiffre de presque 200 000 emplois occupés par des jeunes. Dans un contexte de chômage endémique des jeunes et de difficulté d’insertion sur le marché du travail, l’entreprise sociale peut constituer au moins un marchepied.
Cadre institutionnel de l’ESS au Sénégal : atouts et contraintes
La place de l’économie sociale et solidaire ne cesse de croitre dans le monde en général et au Sénégal en particulier. Cet accroissement se manifeste par la création d’emplois décents, la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. C’est dans ce sens que le Plan Sénégal Emergeant (PSE), principal outil de planification pour le développement économique et social du Sénégal, lui accorde une place de choix en vue d’une « transformation structurelle de l’économie ».
La recherche a révélé un certain nombre de lourdeurs au niveau des procédures. Car même s’il est possible de créer son entreprise en vingt-quatre heures (24h), les entrepreneurs dénoncent aussi la lenteur des procédures dans les différentes structures mises en place par l’État et en appui aux Petites et Moyennes Entreprises. En plus de de la formation, il demeure un problème majeur dans l’organisation des différentes structures d’accompagnement : c’est l’absence de synergie des différentes interventions dans le cadre de l’entrepreneuriat social au Sénégal avec une diversité d’acteurs qui gagneraient à être unifiés.
La forte implication des jeunes dans l’entrepreneuriat social permet l’insertion des jeunes avec des niveaux d’éducation le plus souvent élevés qui trouvent des projets innovants. Il permet aussi à des citoyens avec des niveaux d’éducation modestes et parfois loin de l’employabilité de trouver des emplois plus ou moins décents. Si l’on considère que les entreprises rencontrées déclarent que les jeunes de moins de 30 ans occupent 40 à 50% des emplois, on est dans un chiffre de presque 200 000 emplois occupés par des jeunes. Dans un contexte de chômage endémique des jeunes et de difficulté d’insertion sur le marché du travail, l’entreprise sociale peut constituer au moins un marchepied
Recommandations
Les acteurs et les parties prenantes doivent œuvrer pour la mise en place d’une loi qui définit le périmètre de l’entreprise sociale et qui offre une reconnaissance officielle à ses acteurs. Il s’agit en réalité de lui créer un socle juridique à partir duquel pourront être développés des mesures fiscales ciblées et de nouveaux financements spécialisés.
Il faudrait aussi penser aux sources de financement alternatives. À ce niveau, il est important de définir et structurer des dispositifs de financement et de prêts participatifs solidaires dans les réseaux bancaires. Pour cela, il est nécessaire de reconnaitre, de promouvoir et de faciliter le financement de l’innovation sociale.
Une fiscalité plus adaptée à ces entreprises consiste à pratiquer une taxation plus conforme et des aménagements en matière d’imposition pour soutenir leur développement. Cela peut se faire en pratiquant par exemple une exonération pendant les premières années après leur création afin de les permettre de se développer.
Compte tenu de leurs spécificités, la mise en place de dispositifs de suivi et d’accompagnement des entrepreneurs sociaux permettrait de leur proposer plus facilement des solutions à la mesure des enjeux qui se posent à eux. Ceci est utile aussi bien sur le plan administratif qu’en matière de gestion.
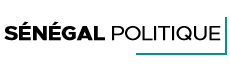
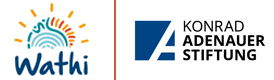
Commenter