Auteur : UNESCO
Site de publication : UNESCO
Type de publication : Rapport
Date de publication : 2022
Lien vers le document original
Introduction
La série « Pleins feux » à deux objectifs :
- Synthétiser, analyser et présenter de façon claire les connaissances comparatives concernant les défis et les solutions pour parvenir à l’achèvement d’une éducation de base universelle et des apprentissages fondamentaux qui serviront de socle aux mécanismes régionaux d’apprentissage entre pairs et aux mécanismes nationaux, régionaux et mondiaux de redevabilité.
- Soutenir les coalitions nationales et régionales dans leur utilisation de ces connaissances comparatives pour faire évoluer les systèmes, les plans, les politiques et les budgets éducatifs nationaux (mais également les mécanismes de soutien internationaux) dans le sens de l’achèvement de l’éducation de base universelle et des apprentissages fondamentaux.
Gouvernance de l’enseignement primaire, secondaire et technique
Le secteur de l’éducation et de la formation au Sénégal est géré par plusieurs institutions. Au sommet se trouvent trois ministères et un organe national. Au bas de l’échelle, on trouve les inspections d’académie (IA), les IEF, les écoles et les organisations parentales et communautaires : les comités de gestion des écoles et les associations de parents d’élèves.
Inscription et achèvement
Bien que des progrès considérables aient été réalisés dans l’enseignement préscolaire, seule une petite proportion des enfants de 3 à 5 ans y a accès : le taux brut de scolarisation y est de 16,1 % pour les garçons et de 18,5 % pour les filles. Ces chiffres ne tiennent pas compte des écoles coraniques, auxquelles de nombreux parents envoient leurs enfants avant l’école primaire, notamment dans les régions où le taux de préscolarisation est faible. Le secteur privé compte 44,8 % des enfants inscrits, le secteur public, 40 % et le secteur communautaire, 15,2 %.
Le taux d’admission brut en cours d’initiation a diminué au durant les dix dernières années. Le taux d’admission brut en cours d’initiation, la première année du primaire, a connu une diminution constante depuis 2010, soit une baisse de 27 points de pourcentage en dix ans. Cette situation est préoccupante, et le taux d’admission brut en cours d’initiation devra atteindre 115 % d’ici à 2030 si le Sénégal veut atteindre les objectifs qu’il s’est fixés.
Le taux d’admission brut est demeuré plus élevé chez les filles tout au long de la décennie, avec des valeurs supérieures à 100 %. Cette situation peut s’expliquer par les politiques de scolarisation qui favorisent les filles. Si la scolarisation des filles a toujours été inférieure à celle des garçons, la situation a radicalement changé dans les années 2000.
Le taux d’admission brut des garçons n’a cessé de chuter, passant sous la barre des 100 % en 2013 malgré une scolarisation précoce (avant l’âge légal obligatoire) et tardive (après l’âge légal obligatoire), un phénomène qui a également été observé chez les filles.
La baisse du taux d’admission brut reflète un rythme de scolarisation (augmentation de 2,9 % du nombre de nouveaux inscrits) inférieur à la croissance de la population d’âge scolaire (3,6 % entre 2010 et 2020), ce qui est dû au manque de salles de classe et d’enseignants pour les nouvelles classes de cours d’initiation.
Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire stagne depuis 2015. La tendance à la baisse du taux d’admission brut a affecté le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui est passé de 94,4 à 85,9 % entre 2010 et 2015, après quoi il a stagné jusqu’en 2020. Le recul de la scolarisation s’est accompagné de fortes inégalités régionales.
Plusieurs études ont montré que pour avoir de bons résultats scolaires, il était important que les élèves disposent de suffisamment d’infrastructures scolaires, de matériel et de ressources éducatives de qualité. Toutefois, à l’heure actuelle, seuls les partenaires techniques et financiers et les autorités locales construisent des salles de classe, mais trop lentement pour accueillir le nombre d’élèves prévu. En 2018, il manquait plus de 8 300 salles de classe. En outre, les salles de classe devenues inutilisables ne sont pas restaurées.
Le taux d’admission brut est demeuré plus élevé chez les filles tout au long de la décennie, avec des valeurs supérieures à 100 %. Cette situation peut s’expliquer par les politiques de scolarisation qui favorisent les filles. Si la scolarisation des filles a toujours été inférieure à celle des garçons, la situation a radicalement changé dans les années 2000
Le taux d’achèvement du primaire a peu évolué entre 2010 et 2020. Au cours des années 2010, il n’y a eu aucune amélioration notable du taux d’achèvement. En 2013, sur 100 enfants en âge d’être en CM2, 60 avaient terminé l’école primaire, contre 62 en 2020. À cet égard, le Gouvernement avait fixé un objectif de 90 % pour 2015, et les progrès de la dernière décennie sont trop lents pour atteindre l’objectif de 97,4 % fixé pour 2030. Cette légère amélioration est en partie imputable à l’amélioration de la situation des filles, chez qui le taux d’achèvement est passé de 65 % à 69,5 %, tandis qu’il a diminué chez les garçons, ce qui a entravé les progrès globaux.
Le taux d’achèvement des filles étant supérieur à celui des garçons, l’indice de parité est en faveur des filles. La stagnation du taux d’achèvement scolaire est le résultat de plusieurs facteurs, notamment la résistance d’une partie de la population au modèle scolaire actuel, qui refuse d’inscrire ses enfants à l’école, le redoublement de certains élèves qui, conformément à la dernière politique en vigueur, auraient dû passer à la classe supérieure, et les taux élevés d’abandon scolaire. Le taux d’achèvement national (62,1 %) cache d’importantes disparités régionales.
Les taux de redoublement et d’abandon dans l’enseignement primaire ont légèrement diminué, tandis que le taux de passage à la classe supérieure a augmenté. Le taux de redoublement a légèrement diminué entre 2016 et 2019, passant de 4 à 3 %. Le taux d’abandon scolaire a lui aussi reculé, passant de 10,3 à 7,9 % sur la même période. Cette double baisse s’est accompagnée d’une hausse du taux de passage à la classe supérieure, qui est passé de 86,1 à 89,2 % entre 2016 et 2019. La diminution du taux d’abandon se traduit par une amélioration de la rétention scolaire avec la progression des élèves du primaire.
Le taux de réussite au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) a considérablement augmenté en 2020. Le taux de réussite au CFEE est passé de 51,9 à 72 % entre 2016 et 2020. Cette forte augmentation s’est produite en grande partie en 2020, qui a connu une hausse de plus de dix points de pourcentage par rapport à 2019. Cependant, les perturbations de l’année scolaire 2019/2020 liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une perte importante de temps d’apprentissage effectif.
Le taux de passage du primaire au collège affiche une tendance à la hausse. Le taux de transition est passé de 68,2 à 74 % entre 2016 et 2019, les chiffres concernant les filles étant légèrement supérieurs à ceux concernant les garçons.
Le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire stagne depuis 2015. La tendance à la baisse du taux d’admission brut a affecté le taux brut de scolarisation dans l’enseignement primaire, qui est passé de 94,4 à 85,9 % entre 2010 et 2015, après quoi il a stagné jusqu’en 2020. Le recul de la scolarisation s’est accompagné de fortes inégalités régionales
Le taux brut de scolarisation au collège a diminué entre 2016 et 2020. Le taux brut de scolarisation au collège est passé de 53,9 % à 50,7 % entre 2016 et 2020.
Le taux de réussite au collège a stagné. Le taux d’achèvement du collège a stagné autour de 37 % entre 2016 et 2020. Cette situation s’explique en partie par l’abandon scolaire, l’orientation des élèves vers les filières professionnelles, les mariages et les grossesses précoces chez les filles.
Analyse des données tirées des évaluations des acquis au Sénégal : financement de l’éducation à partir du PASEC
Le pourcentage d’élèves ayant atteint les niveaux minimums de compétence globaux en mathématiques (PASEC niveau 2 pour les élèves en CP et niveau 3 pour les élèves en CM) et en lecture (PASEC niveau 3 pour les élèves en CP et niveau 4 pour les élèves en CM) s’est amélioré entre 2014 et 2019, en particulier en CE1 où il est passé de 29 à 48 % en lecture et de 62 à 79 % en mathématiques 13). Le pourcentage d’élèves en 6e ayant atteint le niveau minimum de compétences globale en lecture est passé de 35 % en 2014 à 41 % en 2019. En 2019, les élèves en 6e au Sénégal étaient classés premiers en mathématiques et troisièmes en lecture dans les pays participant au PASEC.
Les données du PASEC montrent une grande inégalité entre les écoles et les élèves au Sénégal. Par exemple, le pourcentage d’élèves de CM2 qui ont atteint le niveau minimum de compétence en mathématiques est de 36 % dans les zones urbaines, contre 21 % en milieu rural.
L’écart entre les zones rurales et urbaines était relativement stable entre 2014 et 2019. Pour les deux tiers des résultats scolaires, l’écart entre les zones rurales et les zones urbaines s’explique par les caractéristiques socioéconomiques des élèves issus de ces zones.
Le taux de réussite au Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) a considérablement augmenté en 2020. Le taux de réussite au CFEE est passé de 51,9 à 72 % entre 2016 et 2020. Cette forte augmentation s’est produite en grande partie en 2020, qui a connu une hausse de plus de dix points de pourcentage par rapport à 2019. Cependant, les perturbations de l’année scolaire 2019/2020 liées à la pandémie de COVID-19 ont entraîné une perte importante de temps d’apprentissage effectif
Financement de l’éducation
Entre 1998 et 2018, la part du produit intérieur brut (PIB) consacrée à l’éducation a oscillé en moyenne autour de 4,1 %, mais avec des fluctuations importantes. Si une augmentation continue (de 2,49 à 5,72 %) a été observée entre 2001 et 2014, une tendance à la baisse a démarré en 2015. Au cours de la même période, la part du PIB consacrée à l’éducation a oscillé entre 2,5 et 4,7 %. Par ailleurs, entre 2015 et 2019, la part de l’éducation dans les dépenses publiques totales est passée de 23 à 25,9 %.
Entre 2010 et 2018, près de 70 % du budget consacré à l’éducation et à la formation a été attribué au MEN, le Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation recevant quant à lui une part de 26 % et le Ministère de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’insertion (anciennement Ministère de la formation professionnelle, de l’apprentissage et de l’artisanat), une part inférieure à 4 %. Globalement, la part du MEN a diminué de 4 points de pourcentage, en moyenne, au profit du Ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, passant de 70,7 à 66,2 % entre 2015 et 2018
L’écart important qui existe entre le coût d’un cycle scolaire de 10 ans et le montant actuel des ressources publiques mobilisées constitue toute la difficulté du financement de l’éducation de base. Comment lever des fonds pour répondre aux besoins toujours plus importants d’une population en plein essor démographique?
Voici trois solutions :
- À long terme, des évolutions majeures sont nécessaires, notamment une croissance économique forte et durable, une nette augmentation de la productivité de l’administration fiscale, une transition démographique et une révolution numérique dans le secteur de l’éducation.
- À court terme, les priorités de financement public doivent être radicalement réorientées en faveur de l’éducation et de l’éducation de base.
- Les coûts unitaires (par exemple, le coût par élève en pourcentage du PIB par habitant) doivent être ramenés à des niveaux plus adaptés aux ressources disponibles, même si cela influera sur la qualité de l’apprentissage dans l’environnement scolaire.
Entre 2010 et 2018, le Sénégal a pris l’un des plus gros engagements financiers de l’Afrique subsaharienne en faveur de l’éducation, consacrant systématiquement plus de 5 % de son PIB aux dépenses publiques d’éducation, une part supérieure à la moyenne de l’Afrique subsaharienne et du reste du monde, à savoir, respectivement, 3,7 % et 4,3 %. Entre 2013 et 2018, le Sénégal a consacré à l’éducation une plus grande part de son PIB (5,2 %) que tout autre pays d’Afrique subsaharienne, à l’exception du Kenya (5,3 %).
Entre 1998 et 2018, la part du produit intérieur brut (PIB) consacrée à l’éducation a oscillé en moyenne autour de 4,1 %, mais avec des fluctuations importantes. Si une augmentation continue (de 2,49 à 5,72 %) a été observée entre 2001 et 2014, une tendance à la baisse a démarré en 2015. Au cours de la même période, la part du PIB consacrée à l’éducation a oscillé entre 2,5 et 4,7 %. Par ailleurs, entre 2015 et 2019, la part de l’éducation dans les dépenses publiques totales est passée de 23 à 25,9 %
Priorités du gouvernement en matière d’éducation
Depuis l’indépendance, le secteur de l’éducation a fait l’objet de nombreuses réformes, qui visent toutes à améliorer l’accessibilité, l’équité et la qualité du système. La réforme définie dans le PAQUET 2013-2025 visait à garantir un engagement décennal en faveur de l’éducation de base (cycles primaire et moyen) et à atteindre les objectifs suivants :
- Créer un réseau d’établissements d’éducation de base pour garantir dix ans de continuité éducative à tous les enfants âgés de 7 à 16 ans grâce à une approche holistique, diversifiée, inclusive et intégrée.
- Mettre en œuvre un programme scolaire orienté vers la promotion des disciplines scientifiques et de la technologie avec trois parcours différents : vie professionnelle, formation professionnelle et technique, et enseignement secondaire général.
- Aligner l’organisation institutionnelle, les opérations et le personnel du sous-secteur et des écoles sur le nouveau cycle d’éducation de base.
- Encourager tous les acteurs de l’éducation, y compris les autorités locales, les communautés et les partenaires, à soutenir ce changement de paradigme.
- Élaborer de nouvelles stratégies de mobilisation des ressources à l’appui de la réforme.
S’agissant de l’enseignement moyen, les priorités sont les suivantes :
- L’amélioration de l’articulation du programme de l’enseignement moyen avec celui de l’élémentaire pour assurer la continuité et la qualité des apprentissages.
- Renforcement de la professionnalisation des personnels enseignants et d’encadrement.
- Le développement du réseau d’établissements contribuant à assurer la continuité éducative de 10 ans.
- La mise en place d’un système national de pilotage de la qualité.
- Le renforcement de la gouvernance à tous les niveaux dans une logique de gestion axée sur les résultats, participative et inclusive.
Conclusion et recommandations
La présente étude avait pour objectif de dresser un état des lieux de l’éducation de base au Sénégal. Des progrès considérables ont été révélés en matière d’accès à l’éducation malgré une baisse de la scolarisation.
Néanmoins, le système d’éducation de base demeure confronté à des difficultés considérables qu’il convient de surmonter pour réaliser l’éducation de base universelle et de qualité. Les plus importantes sont les suivantes :
- La faible qualité des enseignants
- La faible qualité de l’apprentissage des élèves ;
- Un financement inadéquat de l’éducation pour soutenir la réalisation des objectifs de la stratégie éducative ;
- L’absence de système harmonisé pour mesurer le niveau d’apprentissage, et de politique relative à l’utilisation des résultats des évaluations ;
- Un faible niveau d’accès à l’enseignement préscolaire et une chute du taux d’inscription à l’école primaire.
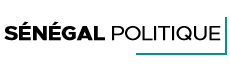
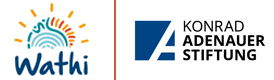
Commenter